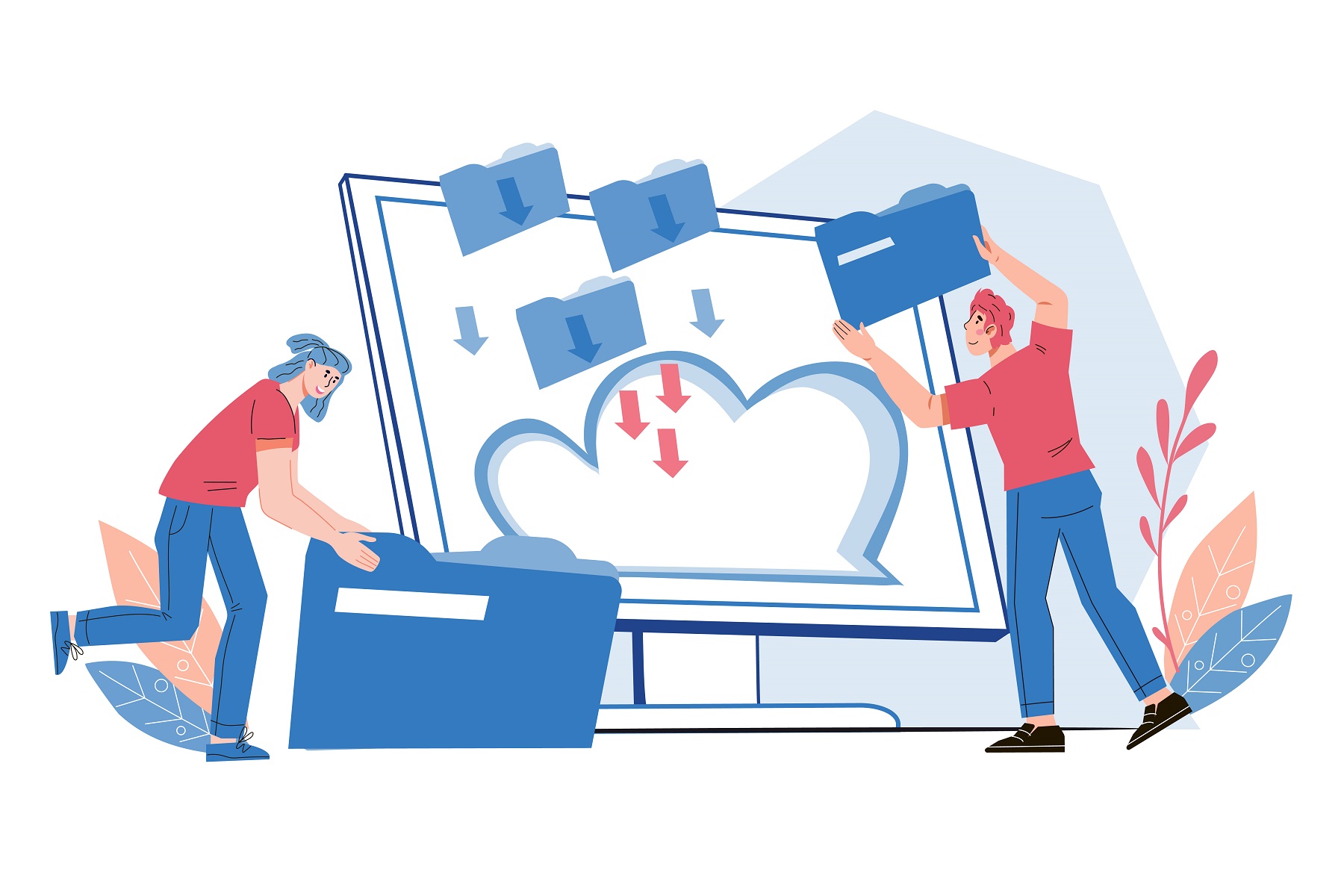Le RGPD prévaut sur le secret des affaires, selon la CJUE
Le RGPD prévaut sur le secret des affaires, selon la CJUE
Dans une décision majeure, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prime sur le secret des affaires. Cette décision éclaire le conflit entre le droit d’accès garanti par le RGPD et le droit à la non-divulgation des secrets commerciaux. Voici une analyse détaillée de cette décision et de ses implications.
Contexte du litige
Une citoyenne autrichienne s’est vu refuser la conclusion ou la prolongation d’un contrat de téléphonie mobile. La raison invoquée était une évaluation défavorable de son crédit, issue d’une prise de décision automatisée. Selon cette évaluation, elle ne présentait pas une solvabilité financière suffisante.
Considérant cette décision injuste, elle a saisi l’autorité autrichienne de protection des données (équivalent de la CNIL en France). Elle a obtenu que l’entreprise responsable du scoring lui communique des informations sur la logique sous-jacente de cette évaluation.
Cependant, l’entreprise a estimé qu’en raison du secret des affaires, elle n’était pas tenue de fournir davantage d’informations que celles déjà communiquées. Elle a donc formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, arguant que la divulgation totale de sa méthode de scoring compromettrait ses secrets commerciaux.
Le Tribunal administratif fédéral a jugé que l’entreprise devait fournir plus d’explications pour permettre à la personne concernée de comprendre comment le score avait été établi. Les informations initiales, indiquant simplement que des données sociodémographiques avaient été « agrégées de manière équivalente », étaient jugées insuffisantes.
Chargée d’exécuter cette décision, l’administration municipale de Vienne a refusé, estimant également que les informations fournies étaient suffisantes. La citoyenne autrichienne a alors déposé un recours devant le tribunal administratif de Vienne.
Ce dernier a ordonné à l’entreprise de fournir :
- Les données personnelles traitées (date de naissance, adresse, sexe, etc.) utilisées dans le calcul du « facteur » de scoring.
- La formule mathématique à la base du calcul du score.
- La valeur attribuée à la personne pour chacun des facteurs concernés.
- La précision des intervalles à l’intérieur desquels la même valeur est attribuée à différentes données pour le même facteur.
L’entreprise devait également fournir une liste de scores attribués à d’autres personnes sur la base de la même règle de calcul, sur une période d’un an (six mois avant et six mois après l’établissement du score de la plaignante).
Entre secret des affaires et RGPD : cadre juridique
Le litige portait principalement sur l’interprétation de plusieurs textes juridiques :
1. Article 15, paragraphe 1, point h) du RGPD
Cet article accorde aux personnes concernées le droit d’obtenir des informations sur l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris le profilage. Il stipule que la personne a le droit d’accéder « au moins à des informations utiles concernant la logique sous-jacente », ainsi qu’à l’importance et aux conséquences prévues de ce traitement pour elle.
2. Article 22 du RGPD
Il prévoit le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques ou affectant de manière significative la personne concernée. Il y a toutefois des exceptions, notamment si la décision est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat, si elle est autorisée par le droit de l’UE ou si elle est basée sur le consentement explicite de la personne concernée.
3. Directive (UE) 2016/943 sur la protection du secret des affaires
Elle définit le secret des affaires comme des informations qui :
- Sont secrètes, c’est-à-dire non généralement connues ou aisément accessibles.
- Ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes.
- Ont fait l’objet de mesures raisonnables pour les garder secrètes.
4. Droit autrichien (Datenschutzgesetz)
L’article 4, paragraphe 6, du Datenschutzgesetz (équivalent de la loi française « Informatique et Libertés ») exclut, en principe, l’accès de la personne concernée à ses données personnelles lorsque cet accès porte préjudice à un secret commercial ou industriel du responsable du traitement ou d’un tiers.
Questions posées à la CJUE
Le tribunal administratif de Vienne a soumis plusieurs questions préjudicielles à la CJUE pour clarifier le conflit entre le RGPD et le secret des affaires. Les principales interrogations étaient :
- Jusqu’où le droit d’accès prévu par le RGPD s’étend-il face au secret des affaires ?
- Quelles sont les exigences matérielles pour que les informations fournies soient considérées comme « utiles » au sens du RGPD ?
- Les informations doivent-elles permettre à la personne concernée de vérifier l’exactitude des données et de contester la décision automatisée ?
Analyse de la CJUE
1. Primauté du RGPD sur le secret des affaires
La CJUE a affirmé que le RGPD, en tant que règlement de l’UE, a une portée générale et est directement applicable dans tous les États membres. Il vise à protéger les droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la protection des données personnelles.
La Cour a souligné que, bien que le secret des affaires soit protégé, il ne peut pas prévaloir sur le droit d’accès garanti par le RGPD. Les responsables du traitement ne peuvent pas invoquer de manière générale le secret des affaires pour refuser de fournir les informations requises.
2. Rôle des juridictions nationales
La CJUE a validé le fait que les juridictions nationales peuvent exiger que les informations soient fournies à l’autorité ou à la juridiction saisie pour évaluer si elles relèvent effectivement du secret des affaires. Cela permet une pondération des intérêts en présence.
La Cour a indiqué qu’une réglementation nationale ne peut pas fixer de manière définitive le résultat de cette pondération, car cela reviendrait à restreindre les droits conférés par le RGPD.
3. Définition des « informations utiles »
La notion d' »informations utiles concernant la logique sous-jacente » est cruciale. La CJUE a interprété ce terme de manière à garantir une compréhension suffisante par la personne concernée.
Elle a estimé que les informations doivent permettre à la personne de comprendre la méthode de prise de décision automatisée, sans pour autant exiger la divulgation de détails techniques ou de secrets commerciaux spécifiques. Autrement dit, il s’agit d’un « droit à l’explication » de la procédure et des principes appliqués.
4. Droit à la vérification et à la contestation
La Cour a également souligné que la personne concernée doit pouvoir vérifier l’exactitude des données utilisées et contester la décision automatisée si nécessaire. Cela implique que le responsable du traitement doit fournir suffisamment d’informations pour permettre cette vérification.
Implications de la décision
1. Pour les entreprises
Les entreprises qui utilisent des prises de décisions automatisées, notamment des systèmes de scoring ou de profilage, doivent être prêtes à fournir des informations claires sur la logique sous-jacente de ces décisions.
- Transparence accrue : Elles doivent expliquer quelles données personnelles sont utilisées et comment elles influent sur la décision.
- Documentation des processus : Il est essentiel de documenter les algorithmes et les méthodes de décision pour pouvoir fournir des explications aux personnes concernées.
- Formation du personnel : Le personnel doit être formé pour comprendre les obligations légales et répondre aux demandes d’informations conformément au RGPD.
2. Pour les personnes concernées
Les individus ont le droit :
- D’être informés de l’existence de prises de décisions automatisées les concernant.
- D’obtenir des explications sur la logique sous-jacente à ces décisions.
- De vérifier l’exactitude des données et de contester les décisions automatisées.
3. Pour les autorités de protection des données
Les autorités sont encouragées à :
- Veiller à ce que les responsables du traitement respectent les obligations de transparence.
- Faciliter la compréhension des droits par les personnes concernées.
- Offrir des lignes directrices pour aider les entreprises à se conformer au RGPD.
Conclusion
La décision de la CJUE clarifie la primauté du RGPD sur le secret des affaires en matière de droit d’accès aux données personnelles et aux informations sur les prises de décisions automatisées. Elle renforce les droits des individus à comprendre comment leurs données sont traitées et utilisées dans des décisions qui les affectent.
Cette décision aura un impact significatif sur les pratiques des entreprises, qui doivent désormais concilier leurs intérêts commerciaux avec les obligations de transparence imposées par le RGPD. Elles doivent s’assurer que le secret des affaires n’est pas utilisé comme un prétexte pour limiter les droits des personnes concernées.
Il est crucial pour les entreprises de réévaluer leurs processus internes, de former leur personnel et de garantir une conformité totale avec le RGPD pour éviter des sanctions potentielles et préserver la confiance des consommateurs.
Points clés à retenir
- Primauté du RGPD : Le RGPD l’emporte sur le secret des affaires en cas de conflit concernant le droit d’accès aux données et aux informations sur les décisions automatisées.
- Droit à l’explication : Les individus ont le droit d’obtenir des informations utiles sur la logique sous-jacente des décisions automatisées qui les concernent.
- Pondération des intérêts : Les juridictions nationales doivent équilibrer les droits à la protection des données personnelles avec le secret des affaires au cas par cas.
- Obligations des entreprises : Les entreprises doivent être transparentes sur leurs méthodes de prise de décision automatisée sans compromettre indûment leurs secrets commerciaux.
Recommandations pour les entreprises
- Audit des processus : Examiner les systèmes de prise de décision automatisée pour identifier les informations pouvant être divulguées sans compromettre le secret des affaires.
- Documentation détaillée : Établir une documentation claire des algorithmes et des méthodes utilisés, prête à être partagée avec les autorités ou les personnes concernées.
- Formation du personnel : Sensibiliser les employés aux obligations du RGPD et aux processus de réponse aux demandes d’accès.
- Communication transparente : Mettre en place des procédures pour fournir des explications adaptées aux personnes concernées, en évitant le jargon technique.
- Consultation juridique : Travailler avec des experts en protection des données pour s’assurer de la conformité avec le RGPD et anticiper les problèmes potentiels.
Perspectives futures
Cette décision pourrait influencer les pratiques commerciales au-delà des frontières autrichiennes, établissant un précédent au sein de l’Union européenne. Elle souligne l’importance croissante de la transparence et de la protection des données dans un monde de plus en plus numérique et automatisé.
Les entreprises devront s’adapter à cette nouvelle réalité, où le respect des droits des individus en matière de données personnelles est non négociable. Cela pourrait également encourager le développement de solutions technologiques qui concilient efficacité commerciale et respect des réglementations sur la protection des données.
Ressources supplémentaires
- Texte intégral du RGPD : Pour comprendre en détail les obligations légales.
- Directive (UE) 2016/943 : Sur la protection du secret des affaires.
- Guides pratiques : Publiés par les autorités de protection des données pour aider les entreprises à se conformer aux exigences.
Conclusion finale
La protection des données personnelles est un enjeu majeur dans notre société moderne. La décision de la CJUE réaffirme le droit des individus à comprendre comment leurs données sont utilisées, en particulier lorsqu’elles influencent des décisions importantes les concernant. Les entreprises doivent prendre cette décision au sérieux et agir en conséquence pour garantir le respect des droits de leurs clients et utilisateurs.
Cette affaire souligne également le rôle crucial des juridictions et des autorités de protection des données dans l’application et l’interprétation du RGPD. Elle rappelle que la protection des données personnelles est une responsabilité partagée, nécessitant la collaboration de tous les acteurs pour créer un environnement numérique sûr et transparent.



 Pour la CJUE, cela ne fait aucun doute. Selon elle, cette mesure
Pour la CJUE, cela ne fait aucun doute. Selon elle, cette mesure 
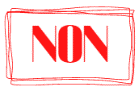 Là se situe le point bloquant de cette mesure pour la CJUE.
Là se situe le point bloquant de cette mesure pour la CJUE. La France s’est dotée de lois similaires. Sur le même principe qu’en Lituanie, une autorité administrative indépendante est investie de la mission de contrôler l’application des règles en matière de prévention des conflits d’intérêts et de lutte contre la corruption : la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
La France s’est dotée de lois similaires. Sur le même principe qu’en Lituanie, une autorité administrative indépendante est investie de la mission de contrôler l’application des règles en matière de prévention des conflits d’intérêts et de lutte contre la corruption : la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
 Lorsque les tribunaux nationaux s’interrogent durant un procès sur le sens à donner à une législation européenne, ils peuvent adresser à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) une question
Lorsque les tribunaux nationaux s’interrogent durant un procès sur le sens à donner à une législation européenne, ils peuvent adresser à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) une question